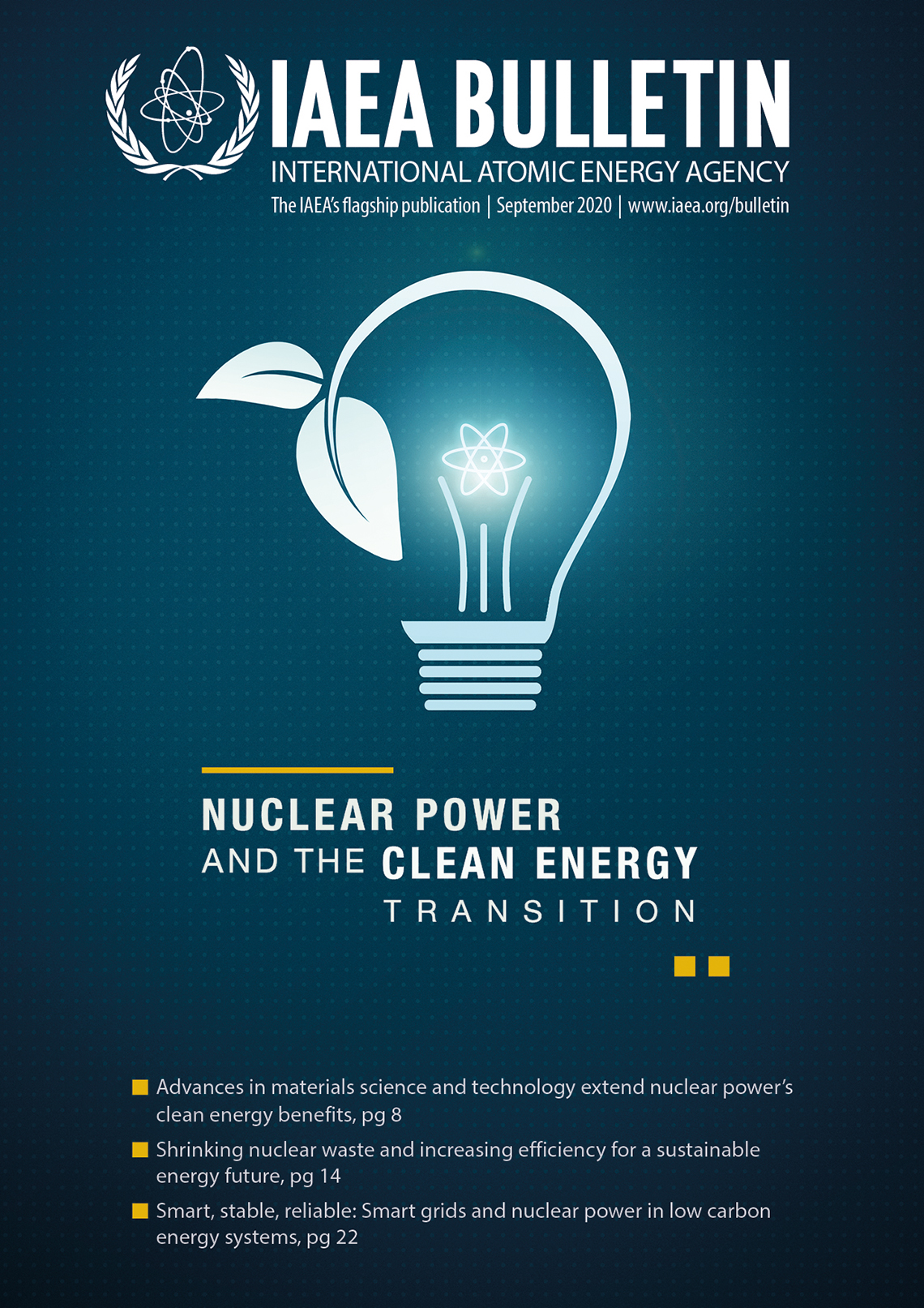L’hydrogène est utilisé dans divers processus industriels, allant de la production de combustibles synthétiques et de produits pétrochimiques à la fabrication de semi-conducteurs, en passant par la charge des véhicules à pile à combustible. Afin de réduire l’impact environnemental de la production d’hydrogène, qui dépasse les 70 millions de tonnes par an, certains pays envisagent de se tourner vers l’électronucléaire.
? Par exemple, si seulement 4 % de l’hydrogène actuellement produit l’étaient à l’aide de l’électronucléaire, les émissions de dioxyde de carbone pourraient déjà être réduites de 60 millions de tonnes par an ?, explique Ibrahim Khamis. ? Et si la production d’hydrogène reposait entièrement sur l’électronucléaire, ce sont alors 500 millions de tonnes d’émissions de dioxyde de carbone que nous pourrions éliminer chaque année. ?
En combinant des réacteurs nucléaires de puissance avec une usine de production d’hydrogène, il est possible de constituer un système de cogénération qui permette de produire efficacement de l’électricité et de l’hydrogène. Pour pouvoir produire de l’hydrogène, un tel système doit être équipé soit d’un dispositif d’électrolyse, soit de composants permettant la mise en ?uvre de processus thermochimiques. L’électrolyse est une technique qui consiste à générer un courant électrique continu pour décomposer des molécules d’eau en hydrogène et en oxygène. L’électrolyse de l’eau liquide s’effectue à des températures relativement basses, entre 80 et 120 °C, alors que l’électrolyse de la vapeur d’eau requiert des températures nettement plus élevées, ce qui rend cette dernière méthode bien plus efficiente. étant donné que l’électrolyse de la vapeur d’eau exige un apport thermique d’environ 700 à 950 °C, elle pourrait constituer une technique idéale pour l’intégration dans des centrales nucléaires dotées de réacteurs avancés à haute température.
Les procédés thermochimiques de production d’hydrogène consistent à dissocier les molécules d’eau en provoquant des réactions chimiques avec certains composés à des températures élevées. Les réacteurs nucléaires avancés fonctionnant à très hautes températures peuvent également être utilisés pour produire la chaleur nécessaire à la mise en ?uvre de tels procédés.
? Le cycle iode-soufre est une méthode de production d’hydrogène qui offre des possibilités très intéressantes pour une exploitation à grande échelle durable et à long terme ?, déclare Ibrahim Khamis. ? Cette méthode très prometteuse est en train d’être mise au point au moyen du modèle japonais de réacteur expérimental à haute température (HTTR) et des modèles chinois de réacteur à haute température HTR-10 et de réacteur modulaire à lit de boulets à haute température HTR-PM 600. D’autres travaux de recherche continuent également d’avancer à grands pas. ?
Plusieurs pays sont en train de mettre en ?uvre ou d’étudier des méthodes de production d’hydrogène à l’aide de centrales nucléaires afin de réduire leurs émissions de carbone dans les secteurs de l’énergie, de l’industrie et des transports. C’est aussi un moyen de tirer davantage profit d’une centrale nucléaire, ce qui peut améliorer sa rentabilité.
L’AIEA fournit un appui aux pays intéressés par la production d’hydrogène au moyen d’initiatives comme des projets de recherche coordonnée et des réunions techniques. Elle a également mis au point le programme d’évaluation économique de l’hydrogène (HEEP), outil d’évaluation économique de la production d’hydrogène à grande échelle à l’aide de l’énergie nucléaire. Elle a en outre ouvert, au début de 2020, un cours en ligne sur la production d’hydrogène par cogénération nucléaire.
? La production d’hydrogène dans des centrales nucléaires pourrait grandement contribuer aux efforts visant à réduire les émissions de carbone, mais il faut d’abord relever un certain nombre de défis, dont la question de la viabilité économique de l’intégration de la production d’hydrogène dans une stratégie énergétique plus globale ?, explique Ibrahim Khamis. ? La production d’hydrogène par décomposition thermochimique de l’eau exige des réacteurs innovants fonctionnant à très hautes températures, et il faudra encore attendre quelques années avant que de tels réacteurs soient mis en service. De même, la recherche-développement sur le cycle iode-soufre devra se poursuivre pendant plusieurs années encore avant que cette technique n’atteigne le niveau de maturité nécessaire à son exploitation commerciale à grande échelle. ? Ibrahim Khamis ajoute que l’obtention d’autorisations pour les systèmes d’énergie nucléaire qui intègrent des applications non électriques constitue un autre défi.